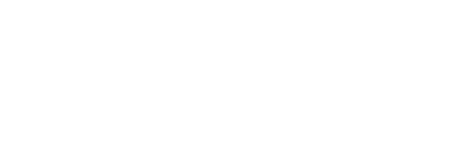Publié le 14/08/2024
Temps de lecture : 5 minutes
Le Fonds vert, dispositif du Gouvernement mis en place en janvier 2023 après son annonce à l’été 2022, est un outil financier innovant destiné à accélérer la transition écologique à l’échelle locale en France. Il soutient financièrement les projets des collectivités territoriales et de leurs partenaires, axés sur trois domaines clés : l’amélioration de la performance environnementale, l’adaptation aux changements climatiques et l’amélioration du cadre de vie.
Reconnaissant l’importance de cet outil pour la planification écologique, le gouvernement a décidé de le prolonger jusqu’en 2027. La gestion des fonds est principalement décentralisée, les préfets de région étant chargés de les distribuer en fonction des besoins spécifiques de chaque territoire, assurant ainsi une réponse adaptée aux enjeux locaux et un accompagnement personnalisé des élus.
En 2023, le Fonds vert a déjà apporté une aide financière à plus de 7 000 porteurs de projets, couvrant près de 6 000 communes en métropole et en outre-mer. Ces initiatives représentent un investissement global de 10 milliards d’euros, dont 2 milliards d’euros proviennent directement du Fonds vert.
Le Fonds vert, c’est quoi ?
Le fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires, ou « fonds vert », est un programme gouvernemental doté de 2 milliards d’euros, visant à soutenir les collectivités territoriales et leurs partenaires dans l’accélération de la transition écologique au niveau local. Ce Fonds Vert (aussi appelé Programme 380 par l’assemblée nationale) vise à lutter contre les crises climatiques, énergétiques et de la biodiversité en soutenant des projets locaux. Il s’articule autour de trois axes principaux :
Axe 1 : renforcement de la performance environnementale
L’un des principaux axes du Fonds Vert est de soutenir les collectivités territoriales dans leurs efforts pour réduire leur impact environnemental et atteindre les objectifs nationaux et européens en matière de transition énergétique. Il se concentre sur 3 domaines principaux :
1. Rénovation énergétique des bâtiments publics locaux tels que les écoles, les mairies ou les hôpitaux. L’objectif est de réduire leur consommation d’énergie d’au moins 40% d’ici 2030 et d’éliminer l’utilisation d’énergies fossiles.
Les projets éligibles vont des solutions à gain rapide (comme le pilotage énergétique ou le remplacement des éclairages) aux réhabilitations lourdes, en passant par l’isolation thermique et le remplacement des équipements de chauffage ou de ventilation. Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les départements peuvent bénéficier de ces subventions, avec une priorité donnée aux projets permettant les plus fortes réductions d’émissions de CO2, aux communes rurales et aux bâtiments scolaires énergivores.
Améliorez votre efficacité énergétique avec Azur Stratégies & Solutions et Primeo Energie.
Optimisez la performance énergétique de vos bâtiments et réduisez votre empreinte carbone grâce à l’audit énergétique proposé par Primeo Energie, en partenariat avec Azur Stratégies & Solutions. Cet audit personnalisé vous permettra d’identifier les sources de gaspillage énergétique et de mettre en place des solutions adaptées à vos besoins, pour des économies d’énergie substantielles et un impact environnemental réduit.
Pour plus d’information, consultez notre site web.
2. Modernisation de l’éclairage public en visant un taux de remplacement annuel de 10% des équipements. L’objectif est de réduire de moitié la consommation électrique de l’éclairage public, tout en privilégiant des éclairages plus respectueux de l’environnement et de la santé humaine. Les projets éligibles comprennent les études de diagnostic, les études d’ingénierie, et les investissements pour le remplacement des luminaires. Les maîtres d’ouvrage de ces projets peuvent bénéficier de subventions, avec une priorité donnée aux parcs les plus anciens ou énergivores, ainsi qu’aux communes de moins de 10 000 habitants en métropole et de moins de 20 000 habitants en outre-mer.
3. Tri et valorisation des biodéchets : l’objectif est d’atteindre un taux de recyclage de 90% des déchets ménagers d’ici 2030. Les projets éligibles concernent l’achat d’équipements de collecte, la création ou l’amélioration d’installations de compostage et de méthanisation. Ce soutien financier vise à développer une économie circulaire des déchets, en transformant les biodéchets en ressources (compost, énergie) et en réduisant l’impact environnemental de nos modes de consommation.
À lire aussi : Vers une France plus verte : tout savoir sur le nouveau tri des biodéchets
Axe 2 : adaptation au changement climatique
Le deuxième axe du Fonds Vert concerne l’adaptation au changement climatique. Il comprend six actions principales visant à protéger les populations, les infrastructures et les écosystèmes :
- Prévention des inondations en finançant des projets d’amélioration de la connaissance du risque, de réduction de la vulnérabilité des habitants et des biens, et de gestion des ouvrages hydrauliques.
- Soutien aux collectivités montagnardes : face aux risques accrus en montagne (déstabilisation des terrains, avalanches, etc.), le Fonds vert finance des actions de prévention pour protéger les populations et les activités économiques.
- Protection des collectivités face aux vents cycloniques.
- Prévention des risques d’incendies de forêt.
- Soutien des collectivités face au recul du trait de côte en finançant la création de cartographies d’exposition au recul du trait de côte et l’adaptation des façades maritimes pour protéger les populations et les biens.
- Renaturation des villes : pour lutter contre les îlots de chaleur urbains, les pics de pollution et les inondations, le Fonds vert encourage la végétalisation des sols, des bâtiments et des équipements publics, ainsi que la création d’espaces aquatiques en ville.
Axe 3 : amélioration du cadre de vie
Le troisième axe du Fonds vert vise à améliorer la qualité de vie des habitants en soutenant cinq types d’actions :
Déploiement des zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) aidant les collectivités à mettre en place ces zones, qui restreignent la circulation des véhicules les plus polluants dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants. L’objectif est d’améliorer la qualité de l’air, de réduire la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre.
Pour en savoir plus sur les zones à faibles émissions, consultez notre article dédié.
Développement du covoiturage : le Fonds vert soutient la création d’infrastructures (aires de covoiturage, voies réservées, etc.) et le développement de services pour encourager cette pratique, qui permet de réduire l’empreinte carbone des déplacements et les coûts de carburant.
Recyclage des friches : le financement couvre les études, les acquisitions foncières, les travaux de démolition, de dépollution ou d’aménagement nécessaires pour recycler les friches industrielles ou urbaines. Cela permet de limiter l’étalement urbain, de préserver les espaces naturels et de revitaliser les territoires.
Accompagnement de la stratégie nationale biodiversité 2030 avec la création d’aires protégées, la protection des pollinisateurs, la lutte contre les espèces invasives, la dépollution des sols, etc. Ces actions contribuent à la lutte contre le changement climatique et à l’amélioration de la santé et du bien-être des habitants.
Appui en ingénierie : le Fonds vert finance l’accompagnement des collectivités par des professionnels pour les aider à concevoir, mettre en œuvre et évaluer leurs projets de transition écologique. Cet appui permet d’améliorer la qualité et l’efficacité des projets, d’identifier les meilleures solutions et de sécuriser leur réalisation.
Comment les projets sont-ils sélectionnés ?
La sélection des projets du Fonds vert se fait au niveau départemental. Le préfet du département est chargé de sélectionner les projets éligibles et de déterminer le montant de la subvention accordée à chacun d’eux. Cette sélection se fait en tenant compte de plusieurs critères :
- Le gain écologique du projet
- La capacité de financement des collectivités locales
- La situation socio-économique du département
Comment déposer un dossier Fonds Vert en 2024 et quels sont les délais d’instruction ?
Le succès du Fonds vert en 2023, avec plus de 17 860 dossiers déposés et plus de 10 400 projets acceptés, témoigne de l’engouement des collectivités pour la transition écologique. Les domaines de la rénovation énergétique des bâtiments publics et de la modernisation de l’éclairage public ont été particulièrement plébiscités.
Pour l’année 2024, les collectivités souhaitant bénéficier du Fonds vert peuvent déposer leur dossier sur la plateforme Aides-territoires. Ce site permet de consulter l’ensemble des aides financières disponibles, ainsi que des fiches explicatives détaillant les critères d’éligibilité et des exemples de projets pour chaque mesure.
Le dépôt de la demande se fait également en ligne, via un formulaire dédié. Il est recommandé de prévoir suffisamment de temps pour le remplir, car il nécessite de fournir des informations détaillées et des pièces justificatives spécifiques au projet.
Le délai d’instruction des dossiers varie généralement entre 22 jours et 4 mois, en fonction de la complexité du projet et de la nécessité d’échanges complémentaires. Il est donc conseillé de déposer sa demande le plus tôt possible pour maximiser les chances d’obtenir un financement.
Articles les plus récents
-
État des lieux énergétique : pourquoi le réaliser chaque année ?
Chaque année, les entreprises doivent composer avec des variations de prix de l’énergie, des obligations réglementaires et des enjeux environnementaux croissants. Pour garder une vision claire et fiable de leurs consommations, elles réalisent un état des lieux énergétique, un outil stratégique qui soutient leur performance économique et technique. Lire plus
-
L’actualité sur les marchés de l’énergie – 11/12/2025
Le gestionnaire du réseau électrique RTE souligne, dans son bilan prévisionnel 2025 actualisé, que la France doit impérativement accélérer sa transition vers l’électricité pour réussir sa décarbonation et réduire sa forte dépendance aux énergies fossiles importées, dont la part doit passer de 60 % à 30-35 % d’ici 2035. Lire plus
-
Monitoring énergétique en temps réel : optimiser sa consommation
Dans un contexte énergétique de plus en plus contraint, les entreprises doivent optimiser chaque kWh consommé. Grâce au monitoring énergétique en temps réel, elles disposent enfin d’une vision précise et continue de leurs usages. Lire plus